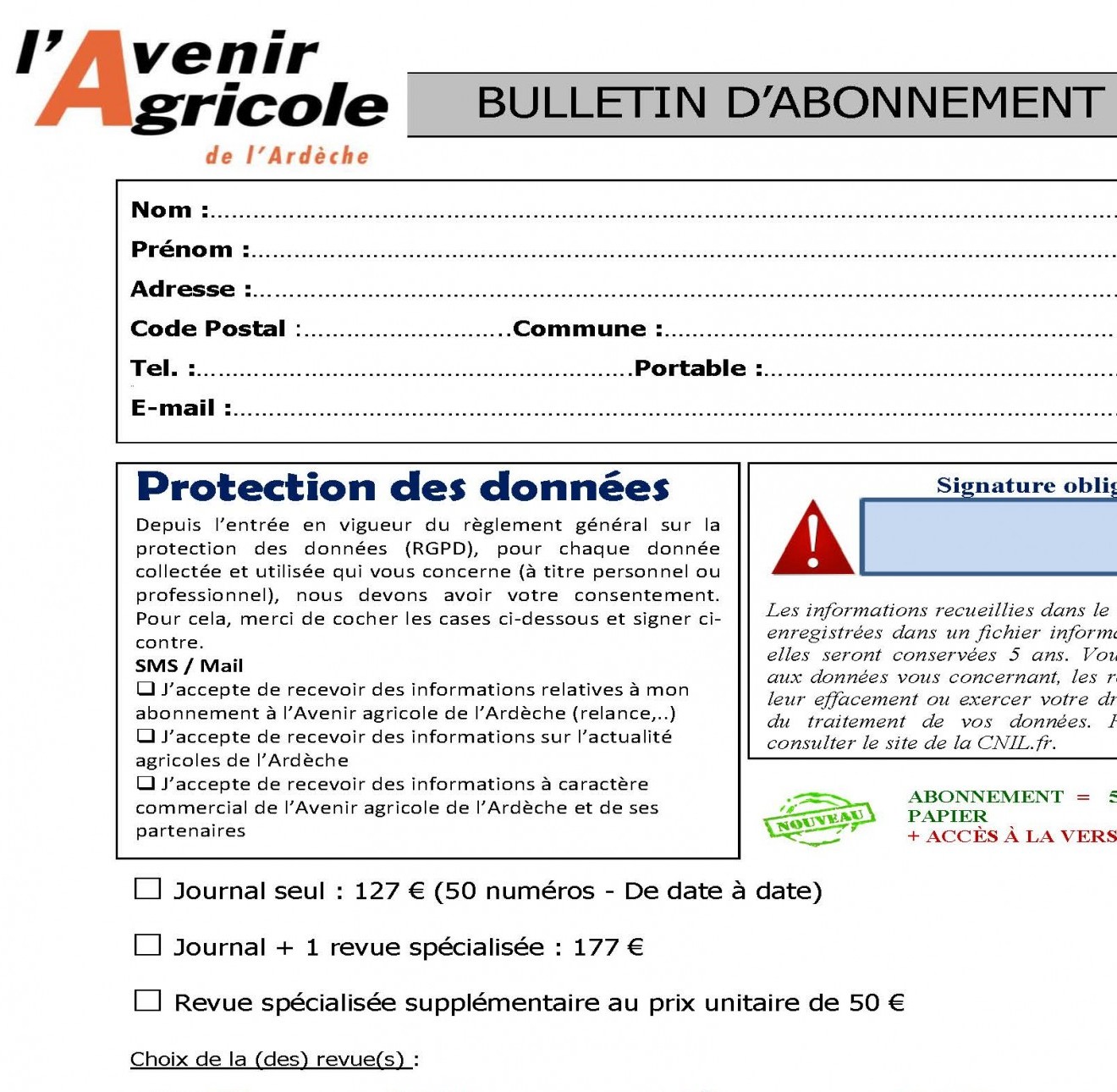AMÉNAGEMENT
Sobriété, attractivité et foncier agricole
Le 8 novembre à Lyas, étaient réunis environ 130 élus et acteurs locaux pour les Premières Rencontres de l’Urbanisme, axées sur la sobriété foncière, à l’initiative de la préfète de l’Ardèche, en partenariat avec l’Association des maires de France de l’Ardèche (AMF07), le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Repenser l’urbanisme et sortir des carcans d’un développement intensif pour s’orienter vers une sobriété foncière, telle était la réflexion menée lors de cette journée où les ateliers participatifs ont rythmé les débats. Le point de départ de chacun des quatre ateliers étant le témoignage d’un élu sur sa propre expérience, abordé sous l’angle d’un des thèmes de la sobriété foncière : optimiser l’existant, retravailler le bâti en préservant le cadre de vie, limiter les impacts environnementaux dans un projet d’extension et améliorer son bilan sobriété en renaturant des espaces. Les acteurs ont pu échanger sur les freins et clés de réussite qui participent à l’émergence d’une nouvelle approche de l’aménagement adapté à nos territoires, plus équilibrée et durable, tout en pointant leurs accords et désaccords autour de sujets leur paraissant essentiels.
Mais dans son propos introductif, la préfète Sophie Elizéon a rappelé avant tout l’importance de préserver les terres agricoles et les espaces naturels pour un développement responsable. Car en filigrane, les questions autour du foncier agricole, ont été prépondérantes dans un territoire aussi rural que l’Ardèche.
Respect du foncier agricole : la sobriété passera par un arrêt de l’extension
Martin Vanier, géographe, a tout au long de la journée consigné les échanges dans son carnet de recherche. Grand témoin de l’évènement, le professeur à l’École d’urbanisme de Paris accompagne de nombreuses collectivités dans leurs démarches de projet territorial. Pour lui, « l’attractivité d’un territoire doit d’abord être abordée sous l’angle économique, avant même d’envisager son attractivité résidentielle et touristique. En Ardèche, par exemple, l’agriculture et l’industrie sont des activités historiques importantes. Cependant, les débats actuels se concentrent essentiellement sur des projets d’urbanisation, au point que l’on néglige l’essentiel de l’espace, qui est majoritairement naturel ou agricole. Le message qui en découle est que, pour préserver cet espace, il faut adopter une approche plus sobre de l’urbanisation, en évitant l’extension excessive et en respectant le foncier agricole. Cette sobriété implique de limiter l’emprise sur les terres agricoles et de réorienter les efforts vers une gestion plus responsable du territoire. »
Car comment mêler attractivité tout en ménageant les espaces agricoles et naturels essentiels à la vie du territoire ? Du côté de la Safer, l’objectif est clair : « Le rôle de la Safer est de sanctuariser l’usage agricole et la vocation naturelle des parcelles et d’optimiser l’utilisation des bâtiments existants lors des transactions portant sur des biens bâtis en zone agricole », rappelle Jonathan Imbert, directeur de la Safer Ardèche, présent lors de cette journée. « Nous sommes donc vigilants face à la consommation foncière masquée d’un terrain, afin que ces terres agricoles ne perdent pas leur usage. » La lutte contre la consommation « masquée » fait d’ailleurs partie de la feuille de route 2022-2028 de la Safer Aura.
Agriculture et territoire : réinventer le lien
Pour le géographe, « dans un pays comme la France, il est absurde d’avoir des projets de territoire sans projet agricole. Mais la question doit être abordée dans sa globalité, en prenant en compte les attentes, les besoins et les usagers, notamment les usagers fonciers, parmi lesquels l’agriculteur est un acteur clé. Cependant, il persiste une séparation entre les mondes de l’urbanisme et de l’agriculture : lorsqu’on parle d’urbanisme, les agriculteurs sont rarement impliqués, et inversement, lorsqu’on traite des questions agricoles, la société urbaine est absente. Ce manque de dialogue génère souvent de l’amertume » , remarque-t-il. Pour le chercheur, il est crucial de réunir tous les acteurs, urbains comme agricoles, pour promouvoir un développement durable et un partage équitable du foncier, d’autant plus dans un monde agricole en crise. « Si on ne reterritorialise pas le projet agricole : le bateau coulera avec ses passagers. Car c’est le bateau d’une agriculture qui a trop divorcé avec le projet local et avec le projet territorial et qui a fait de l’agriculture, une aventure économique mondialisée trop déliée du reste », martèle-t-il. Pour cela, une des solutions, selon lui, viendra en « suivant le même processus que dans d’autres secteurs, comme l’éducation ou l’hôpital, où des communautés territoriales ont été créées », afin de mieux coordonner les efforts entre tous et prévenir les conflits, notamment autour du partage de la ressource en eau ou de l’usage des phytosanitaires.
M.M.