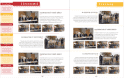Un avenir compliqué pour l’élevage français ?
L’institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) a organisé, début juillet, un colloque sut le thème : « De l’éleveur au consommateur : quels enjeux pour les filières de la viande en France ? »

« Accroissement du déséquilibre offre-demande sur le marché domestique pour toutes les filières avec un taux de couverture passant de 98 % en 2020 à 87 % en 2035 ; érosion des structures moyennes et de petites tailles ; des fermes comme des industries, avec une réduction de 34 % des fermes élevant des animaux et 31 % des emplois associés, ainsi qu’une disparition de 20 % des outils d’abattage-découpe et 14 % des emplois agro-industriels. » Telles sont les principales conclusions du scénario tendanciel du rapport de l’Iddri1 sur les trois principales filières viandes en France (porcs, volailles et bovins). Ce scénario tout à fait plausible « n’est pas souhaitable », a d’emblée signalé Léna Spinazzé, directrice générale adjointe de l’Iddri. Deux fois moins productifs L’objectif est de pouvoir objectiver le débat dans un secteur éminemment « complexe », en vue de sortir d’une polarisation réguli&...
La suite est réservée à nos abonnés.